 |
 |
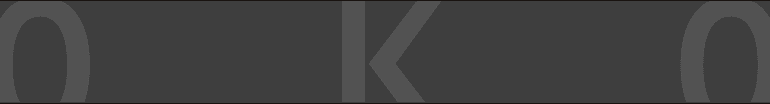 |
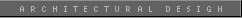 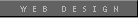 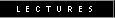 |
DUNCAN, Carol, Civilizing rituals : Inside the public art museums, Routledge, New York, 1995.
Introduction
À la page 3, Duncan explique ce qu'elle fera dans chaque chapitre :
À la page quatre, elle décrit les limites de son étude : elle ne s'est intéressée qu'aux exemples de musées dans les démocraties occidentales et en particulier aux exemples anglo-américains. Mais elle est consciente de ne pas vouloir faire une histoire générale des musées dans le monde mais plutôt d'étudier les aspects rituels de certains d'entre eux. Par contre, elle prétend que tous les musées participent à l'histoire de la culture bourgeoise. Cette affirmation laisse supposer, malgré les limites géographiques de son étude, qu'elle rend bien compte de ce phénomène de la " culture bourgeoise ". Une autre limite de son étude, selon elle, est qu'elle n'aborde pas la question de savoir comment les musées occidentaux représentent les autres cultures. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir ce que les musées occidentaux nous apprennent sur la culture occidentale.
À la page cinq elle explique en quoi son étude diffère des autres études sur les musées d'art : 2. Son livre n'est pas une étude sociologique de l'art du genre où on amasse des données sur les lectures - interprétations - du musée par les visiteurs à partir d'un échantillon représentatif. Par contre, elle dit partager certaines conclusions des études de Pierre Bourdieu et de Alain Darbel sur les visiteurs de musées (leur étude menée dans les années 60 leur révélait que la visite des musées provoquait chez certaines personnes le sentiment d'appartenance culturelle alors que chez d'autres elle suscitait un sentiment d'infériorité et de rejet). Selon Duncan, les conclusions de Bourdieu et de Darbel viennent entériner son hypothèse sur les mises en scène de rituels dans les musées [elle n'explique toutefois pas clairement pourquoi]. Alors que Bourdieu et Darbel considéraient les résultats de leur étude en terme d'identités de classe, elle prétend que les musées sont des structures comportant du contenu culturel important et qu'ils ne peuvent se réduire à n'être que des producteurs d'idéologie ou des produits des intérêts sociaux et politiques. Duncan s'attarde ensuite à expliquer la connotation des mots artifact et ritual qu'elle utilise fréquemment dans son livre [intéressant]. Artefact : les artefacts se distinguent généralement des oeuvres d'art tant au niveau conceptuel que comme objets de musée. La distinction entre artefact et œuvre d'art reflète la division entre anthropologie et histoire de l'art (et critique d'art). Elle reflète également la hiérarchie entre sociétés non-occidentales et occidentales : la première produit des objets qui n'obtiennent aux yeux des occidentaux que le statut d'artefact alors que la seconde produit ce qu'on considère de l'art. Cette distinction repose sur l'idée que seules les oeuvres d'art possèdent les qualités philosophiques et spirituelles suffisantes leur permettant d'être isolées pour la contemplation esthétique. Selon cette logique, l'œuvre d'art trouve sa place dans les musées d'art qui sont là pour que les visiteurs puissent la contempler et l'artefact trouve sa place dans les musées ethnographiques, anthropologiques ou d'histoire naturelle où il peut être étudié comme spécimen scientifique. Il y a quelques années, cette catégorisation hiérarchique a été remise en question par l'octroi du statut d'œuvre d'art à certains artefacts : d'où la création d'ailes ou de sections d'art primitif dans les musées d'art. Duncan mentionne qu'elle traite les musées d'art comme des artefacts rituels non pas pour leur assigner une valeur quelconque mais pour aider à mieux comprendre comment ils construisent et communiquent du sens, de la signification. Comme pour le terme artefact, le terme rituel est traité généralement comme un élément inférieur d'une hiérarchie. Duncan rejette la dichotomie art/artefact et refuse d'accorder une position inférieure au terme rituel ("l'autre" : celui du "rituel d'une autre culture" : sens utilisé fréquemment en anthropologie). La raison qu'elle évoque : elle n'est pas anthropologue et n'étudie pas les rituels d'une culture exotique mais plutôt la nôtre et s'intéresse à un des espaces les plus prestigieux de notre culture.
1. The art museum as ritual 7. Dans ce chapitre, l'auteur aborde de façon générale le thème du rituel et des musées. La base de son argumentation repose sur le fait que le caractère rituel des musées a été reconnu [par qui ?] depuis aussi longtemps que les musées publics existent et cet aspect est souvent perçu comme l'accomplissement de l'objectif des musées. L'auteur souligne la ressemblance architecturale entre les musées et les monuments plus vieux dédiés aux rituels et se fonde sur cette similitude pour établir un premier parallèle entre musées et rituels. [À mon avis cet argument est peu valable puisqu'on peut trouver de nombreux exemples d'autres édifices qui ont pris comme modèle l'architecture des temples traditionnels et qui ne sont pas des musées ni des lieux "ritualisés" : plusieurs anciennes banques de Montréal par exemple ou encore d'anciennes églises transformées en condo.] Elle mentionne que "notre culture" distingue les édifices religieux des édifices séculiers depuis le démantèlement du pouvoir et de l'influence de l'Église provoqué par les Lumières. Depuis cette époque, la séparation des pouvoirs religieux et de l'État est nette. Duncan affirme que maintenant la vérité séculière fait figure d'autorité absolue alors que la religion ne préserve son autorité qu'auprès des croyants volontaires. C'est la vérité séculière, une vérité rationnelle et vérifiable, qui a obtenu le statut de savoir objectif. Les musées appartiennent, selon Duncan, à ce champ de savoir séculier à cause des disciplines scientifiques et humaines qui leur sont rattachées (archéologie, histoire de l'art) et aussi parce qu'ils sont les gardiens de la mémoire culturelle officielle de la société. 8. Malgré que l'on associe les rituels aux pratiques religieuses et magiques, Duncan pense que nos sociétés soi-disant rationnelles sont remplies de situations et d'événements ritualisés. Nous construisons des lieux qui représentent publiquement nos croyances à propos de l'ordre du monde, à propose de son passé et de son présent, et la place de l'individu dans ce monde. Les musées sont d'excellents exemples de ce genre de constructions symboliques. Contrôler un musée selon Duncan signifie contrôler la représentation de la société et de ses plus importantes valeurs et vérités. C'est aussi exercer le pouvoir de déterminer la place relative des individus dans la société. [Affirmation discutable : est-ce que les musées sont un vecteur important des valeurs d'une société et un facteur primordial pour déterminer la place des individus dans la société ? Hum, je n'en suis pas si sûr]. Ceux qui sont le plus aptes à s'adonner à son rituel (les visiteurs) sont ceux dont leur identité (sociale, sexuelle, raciale, etc.) est la plus fortement confirmée par le musée.
À la page neuf, Duncan revient sur la ressemblance architecturale entre les musées et les édifices plus anciens voués aux rituels. Elle énumère les points communs entre ces deux types : 12. Jusqu'à maintenant, les arguments de Duncan sur le caractère rituel des musées sont basés sur leur caractéristique temporelle et spatiale ainsi que sur l'attention particulière qui est portée à ces lieux. [À mon avis, ces caractéristiques ne sont pas suffisantes pour définir un musée comme lieu ritualisé. Plusieurs bibliothèques répondent souvent à tous ces critères]. Elle ajoute à cela qu'un rituel implique un élément d'interprétation (performance) de la part des visiteurs. Et elle explique en quoi la visite d'un musée est comme un rituel : 13. Elle aborde en dernier lieu la question des objets des musées qui sont la cause de l'existence des musées. [Elle n'insiste pas assez sur l'importance des objets qui sont à mon avis la raison principale du caractère rituel des musées].Selon elle cette pratique de placer des objets dans des endroits conçus pour qu'on puisse les contempler est assez récente. C'est au XVIIIe siècle à son avis que les critiques et les philosophes ont démontré de l'intérêt pour l'expérience visuelle et qu'ils ont commencé à attribuer aux oeuvres d'art le pouvoir de transformer les gens qui les regardent spirituellement, moralement et émotivement. À son avis, le développement des musées est une conséquence de cet intérêt des philosophes dans le pouvoir esthétique et moral des oeuvres d'art. L'intérêt au XVIIIe siècle pour l'expérience artistique et esthétique dénote une tendance générale à doter le monde séculier de nouvelles valeurs. Selon Duncan, l'invention de l'esthétique peut être perçue comme un transfert des valeurs spirituelles appartenant au monde sacré vers le monde séculier. Duncan donne ensuite plusieurs exemples de cette expérience spirituelle qu'offre la vue d'oeuvres d'art chez : Goethe, Niels vons Holst, Wilhelm Wackenroder, William Hazlitt. À la page 16 et 17, Duncan discute des tendances des musées au XIXe et XXe siècle :
Résumé Je pense que les réponses de Duncan à propos des musées et de leur rapport au rituel sont problématiques et incomplètes. Elle a une hypothèse intéressante qui la laisse croire que les musées sont des lieux où prennent place certains rituels comme c'était le cas dans des époques passées des temples et des églises. En quelque sorte, le musée aurait remplacer nos églises. Pourquoi les musées peuvent-ils être considérés comme des lieux ritualisés ? Voici un condensé de ses réponses : À mon avis, la particularité des musées, c'est leurs collections.
2. From the princely gallery to the public art museum : The Louvre Museum and the National Gallery, London 21. Duncan traite dans ce chapitre des musées du Louvre et de la Galerie Nationale de Londres. Elle pose la question suivante dans ce chapitre :
Elle propose aussi une autre formulation de la même question : Pour reprendre les formulations de Pomian, on pourrait dire que Duncan s'intéresse essentiellement à connaître l'invisible, c'est-à-dire connaître les raisons pour lesquelles on collectionne et présente des objets dans les musées. Pour Pomian, le nouveau culte c'est celui dont la nation se fait en même temps le sujet et l'objet : hommage à elle-même, à son passé, etc. L'invisible des sémiophores des musées c'est le passé et le futur : en mettant des objets dans les musées, on les expose au regard non seulement du présent mais aussi des générations futures.
Voici ces raisons : Le rôle principal des collections, sur lequel se greffent tous les autres, est celui de lien entre l'invisible et le visible. Signification des sémiophores dans les musées : musée = institution dont la fonction consiste à créer un consensus autour de cette manière d'opposer le visible et l'invisible, donc autour de nouvelles hiérarchies sociales. Selon Pomian, le musée prend la relève des églises. "Leur nombre croît au 19e et au 20e siècle au fur et à mesure que grandit la désaffection des populations pour la religion traditionnelle".
|
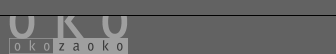 |
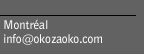
|
|